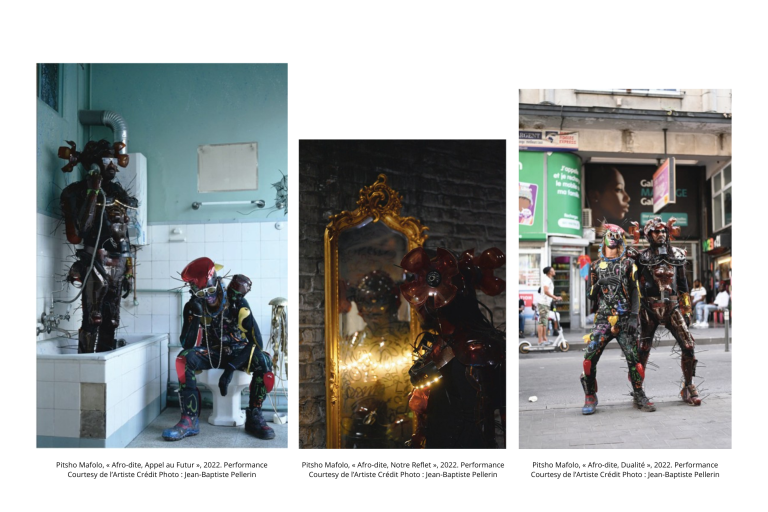« Gagner a toujours consisté à vaincre un ennemi historique, social, politique et culturel qui s’est avéré être le même homme, le même venu d’ailleurs. Celui qui a transposé son histoire à la mienne. Et depuis que j’ai pu en parler jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas changé d’un iota, ni ses méthodes, ni son paradigme. Dernièrement j’ai réalisé que cet autre pan de l’histoire pesait sur lui, le détruisant d’une manière que j’aurais cru impossible. ».
Alors, « Petit à petit », il a commencé « à l’inclure, lui et sa nature violente et brutale », dans sa réflexion visuelle, « créant de la beauté à travers lui comme des rayons de soleil à travers du verre fin. Et ce qui est apparu de l’autre côté » l’a « profondément surpris : c’était de l’espoir. »
Un espoir que Damien Jélaine, né à Pointe-à-Pitre et diplômé en cinéma de l’Ecole Saint-Charles de l’Université Panthéon Sorbonne, met avec sagacité dans l’engagement, la force et le message de son travail.
Coup de Cœur.

Asakan : Pour commencer notre entretien, pouvez –vous vous présenter ?
Damien Jélaine : Je m’appelle Damien Jélaine. Je suis un cinéaste et photographe guadeloupéen de 33 ans. Je me définis également comme un révolutionnaire noir, dans à peu près tous les sens que l’on puisse donner à ce terme, et depuis peu, ouvertement anti-IA générative.
Asakan : Quelle définition faites-vous de l’art ? Comment percevez-vous l’art contemporain ?
Damien Jélaine : L’Art est la conscience humaine, armée par l’imaginaire. L’art est le juste poison qui ruisselle entre les plus hermétiques palissades ennemies pour en défaire les défenses. Il est la preuve de l’existence et l’annonce de sa fin. Il est l’enfant dérangeant à la table froide de toute convenance. Il est l’impitoyable compas, tantôt témoin, tantôt stratège, de nos natures humaines, nos civilisations trouées, nos morales bradées, nos beautés partiales, nos histoires condamnées et nos mouvements perpétuels.
Mais encore et surtout, l’art est avant tout une arme. Celle qui supplante toutes les autres, physiques, spirituelles et politiques. Celle dont le degré de contamination ne s’estompe jamais. Et comme toute arme, celui ou celle qui l’a en main se doit, dans une absolue prise de responsabilité, d’en connaître et comprendre la puissance, la portée et l’importance, et de ne jamais les prendre pour acquises ou en vendre les arcanes à qui il ou elle fait la guerre.
Que l’art chante la propagande des bêtes coloniales ou qu’il aiguise les lances des corps en résistance, son impact doit être sans cesse mesuré, réajusté, recalibré pour servir, au-delà du temps et autres réécritures historiques.
L’art contemporain d’aujourd’hui, est ce petit enfant attardé à qui l’on lance des ordres simples pour en nourrir la docilité. Il est perdu, faible, mais se complaît néanmoins dans sa propension à satisfaire des maîtres qui ne lui accordent de l’attention que quand il se comporte sagement, lorsque sa fougue ne bouscule pas. Que ce soit en créant tout un courant de misérabilisme noir dont est friand le marché européen ou lorsqu’il cherche l’empathie de l’œil ennemi dans sa prescription de tout jugement. Il ne déplace plus les corps en révolte, ne permet plus la juste colère des opprimés, n’effleure plus la mortalité des oppresseurs. L’art contemporain est une force apprivoisée, dont les chaînes sont dissimulées par les voiles invisibles de la surexposition du médiocre, de l’effacement des artistes radicaux (les vrais) et de l’avènement du Contenu et de ses adeptes insubmersibles. Une putain de machine frauduleuse et mercantile dont les érosions qualitative et morale ont facilité le démantèlement de bien des révoltes et soulèvements ces vingt dernières années.
Asakan : Quand avez-vous su que vous consacriez votre vie à l’art ?
Damien Jélaine : Je pense qu’à l’âge de 7 ans, lorsque maman est rentrée du travail avec une cassette VHS de Terminator de James Cameron, et après visionnage, j’ai su.
J’ai su que je voulais mettre en image ce qui ne le serait jamais si je ne le mettais pas en image. Qu’il s’agisse d’une histoire, d’un souhait, d’un crachat ou d’une déclaration. Cette faculté qu’ont certains humains à pouvoir traduire en matérialité ce que le monde susurre à l’esprit… J’ai trouvé ça absolument magique. Avant toute politique et colère noire. Juste être une imprimante à rêves. Et de là, j’ai tenté de ne jamais cesser.
En 2009, je suis parti étudier l’esthétique et la théorie du cinéma à Paris. J’ai par la suite réalisé deux longs-métrages, Karukera Fever en 2011, en Guadeloupe, et Public Bitches en 2014, à Paris, pour lequel j’ai remporté le prix du meilleur scénario au World Music and Independent Film Festival de Washington D.C.
Entre-temps, s’est greffée la photographie, et avec elle un nouveau langage, une nouvelle arme, des expositions, des rages saines et de nouveaux ennemis.

Courtesy de l’Artiste
Asakan : En tant qu’artiste, comment décririez-vous votre art ? Comment êtes-vous parvenu à la finalisation de votre empreinte ?
Damien Jélaine : Je dirais que mon art puise tout ce qu’il peut dans la contre-offensive. Dans la postérité vindicative des plus braves d’entre nous, ceux qui nous ont précédés. Mon art reconnaît la nature des miens et celle des dévoreurs de mondes, les Européens. Il ne cherche pas à comprendre ce qui nous lie à notre passé, présent et futur coloniaux, mais à rompre avec, sans compromis ni poésie, avec comme outils de prédilection le beau, le brutal, le détail et l’amour noir. Je le décris souvent comme le photojournalisme d’une guerre invisibilisée, d’un charnier silencieux. Pour ce faire, j’explore deux techniques distinctes qui sont devenues essentielles à mon processus photographique.
La première, que j’ai appelée « Photopiecing », consiste à photographier une vaste gamme d’éléments visuels et d’en constituer une banque photo personnelle. Je capture les paysages et éléments naturels de la Guadeloupe, des nuages des Antilles à la végétation endémique, en passant par les montagnes de la Désirade et les forêts marquées par l’histoire.
Mon travail intègre aussi des matières organiques, des textiles, des liquides variés et des modèles d’origines européenne et caribéenne pour explorer différentes textures et contrastes.
La deuxième technique, le « Photobending », est une découpe et un pliage méticuleux des photographies à l’aide de Photoshop, les préparant soigneusement au compositing. J’extrais de cette découpe plusieurs éléments spécifiques de chaque photo, tandis que le pliage me permet de les agencer et de les superposer de manière précise et détaillée, aboutissant à un réalisme anatomique clinique.

Courtesy de l’Artiste

Courtesy de l’Artiste

Courtesy de l’Artiste
Asakan : Quelles sont vos inspirations artistiques, vos influences ? Les thèmes et émotions que vous essayez de transcrire dans vos œuvres ?
Damien Jélaine : Tout au long de mon parcours artistique, j’ai été profondément marqué par les œuvres de photojournalistes renommés. C’est James Nachtwey en Europe de l’Est et des mères éplorées pleurant leurs fils perdus alors que leurs restes sont exhumés d’une fosse commune. C’est Sebastião Salgado au Soudan, où la famine est utilisée comme arme de destruction massive en temps de guerre. C’est Don McCullin au Congo et les mercenaires blancs en plein safari nègre à ciel ouvert. Ce sont les flammes de l’enfer impérialiste jaillissant de la terre du Koweït en 1991. Ce sont les cicatrices profondes infligées par la nature humaine à la nature humaine, inlassablement. Et parmi tout cela, ces gars s’armaient de beauté ; l’outil ultime pour que les masses occidentales fragiles, anesthésiées par le confort et l’opulence, puissent entrevoir l’horreur partagée de l’autre monde.
Je trouve, entre autres, l’inspiration dans les travaux de Frida Kahlo, Takato Yamamoto, Thomas Sankara, Chester Himes, Kanye West, Malcolm X, Alfonso Cuarón, Oliviero Toscani, Kurt Cobain, Ernesto Guevara, Samuel Huntington, Amiri Baraka, etc.
Asakan : Quel est le regard porté sur votre travail par le public ? Par le milieu artistique ?
Damien Jélaine : Avant toute chose, mon travail semble lever un tabou, celui de la présence et de la destruction du corps blanc dans l’art visuel noir. En choisissant de ne pas dissimuler ou même conceptualiser/imager/symboliser l’ennemi en une autre forme ou quelconque allégorie lâche, je pense que le public (quel que soit son origine) se trouve bien plus à nu face à ce choc des corps et de l’Histoire. Il ne peut donc que l’affronter, quel que soit le camp choisi par son œil. Beaucoup des nôtres m’ont remercié au fil des années de pouvoir leur offrir des corps noirs et/ou racisés puissants, délivrés de l’éternelle douleur formelle érigée en véritable grammaire-nègre (qui n’est pas du tout une catharsis, n’en déplaise à certain(e)s).
Du côté de l’Autre, il y a eu, à ma grande surprise, une réponse en majorité très positive quant à l’espace donnée à l’expiation de son histoire, et de tous ces maux ethniques, sociaux et politiques qui nous lient tous, encore, au crépuscule de ce premier quart de siècle. Cependant, le marché de l’art n’est pas très à l’aise avec l’idée d’un artiste guadeloupéen posant sa réflexion autour de la rétribution. L’art dit engagé ou politique est, depuis plusieurs années, affalé sur l’autel de la dénonciation et de l’empathie collective. Sur ce pale autel fallacieux, l’ « artiste » peut dire sa douleur, quémander son émancipation, négocier son droit à la dignité, reproduire le mal commis sur les mêmes corps, allégoriser sa lutte, s’en prendre à des figures publiques désignées. Mais il ne peut pas, à la manière d’un Quentin Tarantino des années 2010, corriger l’Histoire en inversant le rapport de force, en transformant les défaites des minorités en fantasmes de victoires ou en détruisant visuellement les corps et les peuples antagonistes.

Courtesy de l’Artiste

Photographie Courtesy de l’Artiste

Courtesy de l’Artiste
Asakan : Quels conseils aimeriez-vous transmettre à d’autres jeunes désireux de se lancer dans l’art ?
Damien Jélaine : Je dirais simplement que si l’art devient inoffensif, nous cessons d’exister.
S’il devient entièrement artificiel, nous cessons d’exister.
S’il est une jeunesse qui désire se lancer dans l’intime mission collective de créer pour tenter d’éclaircir ce que nous sommes, qu’elle se porte garante de l’exclusive humanité et de la dangerosité de l’art.
Si ces hommes et ces femmes sont prêts à faire basculer le monde pour s’en assurer, alors tout ce que nous entreprenons, aujourd’hui n’aura peut-être pas été en vain.
Ils ont ma plus sincère bénédiction.
Pour plus d’informations sur le travail de Damien Jélaine,
La Rédaction.